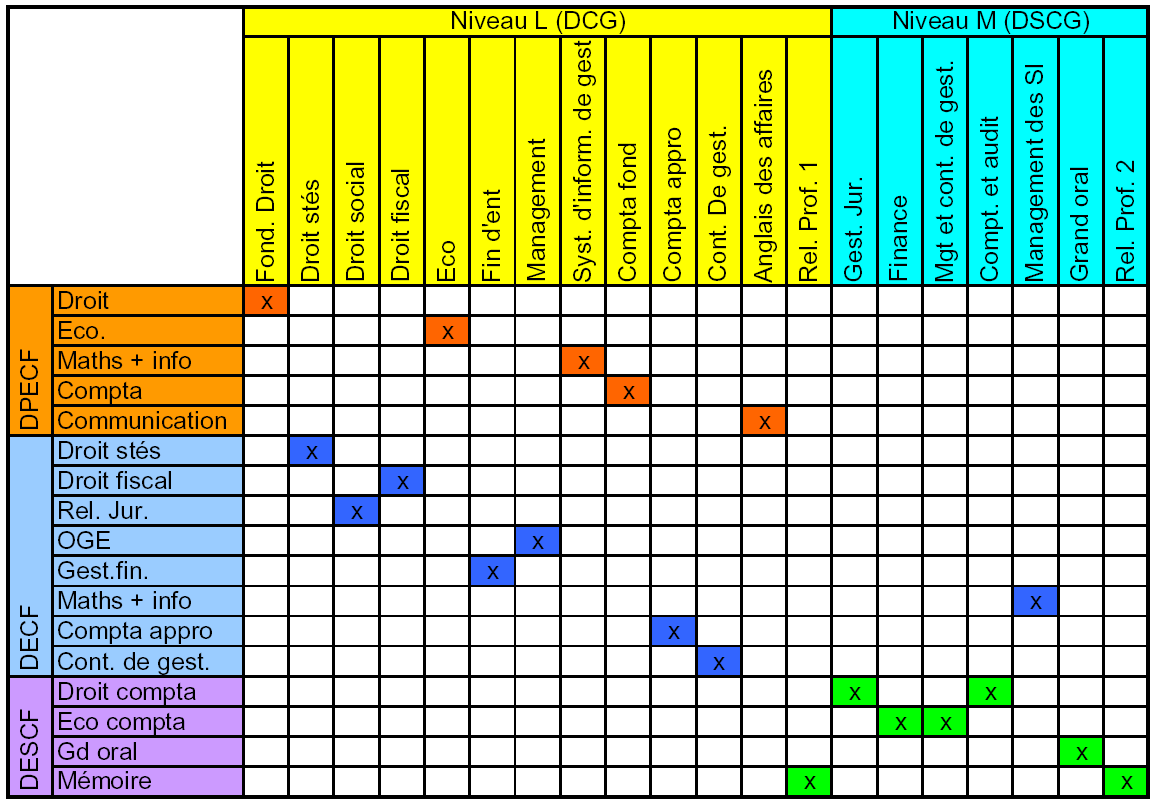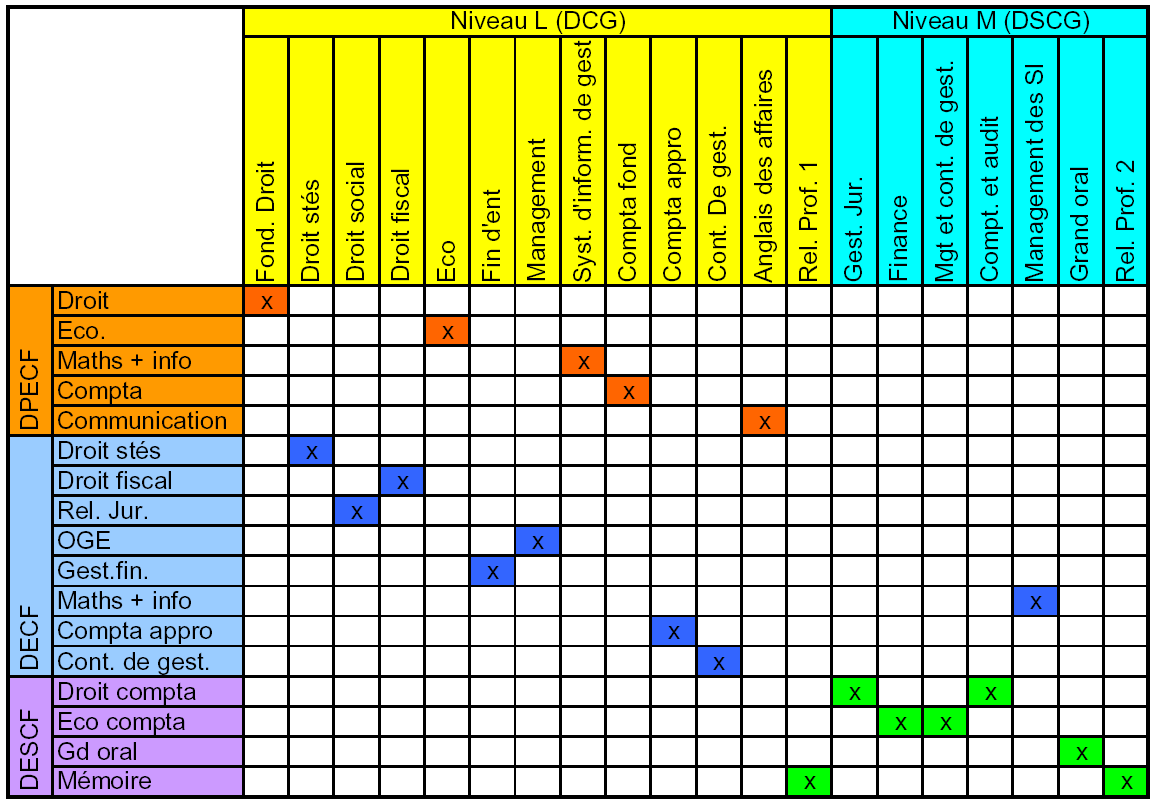La réforme projetée a un objectif :
-
Harmoniser le cursus avec le
schéma LMD applicable à l’ensemble de l’enseignement supérieur des pays
de l’Union européenne. Il faut donc substituer aux trois diplômes
actuels (DPECF, DECF et DESCF) qui précèdent, le cas échéant, le stage
réglementaire de trois ans, deux diplômes clairement positionnés à + 3
(niveau L) et + 5 (niveau M).
-
Harmoniser le cursus avec les
référentiels et modèles de formation européens et internationaux
applicables à la profession
-
8ème directive
(actuellement en cours de révision) ;
-
normes de formation (IES 1
à 6 et IEG 11) de l’International Federation of Accountants (IFAC) ;
-
Common Content élaboré par
huit organisations professionnelles européennes dont le Conseil
supérieur de l’Ordre des experts-comptables et la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes) ;
-
Global Curriculum préparé
par la Conférence des Nations Unies pour la Coopération et le
Développement (CNUCED).
Au delà de cette nécessaire
harmonisation, cette réforme traduit aussi une triple ambition
-
Elle doit garantir que les
professionnels comptables, libéraux ou salariés, auront dans l’exercice
de ces différents métiers, les compétences générales et techniques de
haut niveau qu’attendent les entreprises et le public.
-
Elle doit permettre le
recrutement d’une grande diversité de profils professionnels.
-
Elle doit favoriser une
mobilité des étudiants et des professionnels tout au long de la vie
fondée sur la compétence grâce à une organisation souple mais sans
jamais sacrifier le niveau de connaissance qui est attesté par des
diplômes d’Etat.
Schema LMD :
L = licence (bac + 3)
M = master (bac + 5) et
D = doctorat (bac + 8)
IES : International Education Standard
IEG : International Education Guideline
Les normes de l’IFAC sont disponibles (en anglais) sur le site de l’IFAC (www.ifac.org).
Les autres référentiels peuvent être obtenus au Conseil supérieur de
l’ordre des experts-comptables. Ils sont également en anglais.
L’intégration des formations comptables dans la nouvelle organisation de
l’enseignement supérieur français, la prise en compte des normes et
modèles européens et internationaux et le respect de nos traditions font
peser un certain nombre de contraintes :
-
Les programmes doivent être
découpés en unités d’enseignement (UE) indépendantes et capitalisables
sans limite de temps.de trois ans, deux diplômes clairement positionnés
à + 3 (niveau L) et + 5 (niveau M).
-
Chaque UE se voit attribuer
un certain nombre d’ECTS. Le diplôme de niveau L doit correspondre à 180
ECTS et le diplôme de niveau M à 120 ECTS supplémentaires, soit au total
300 ECTS.
Des entrées ou des sorties à
différents niveaux du parcours doivent être possibles ; le modèle du «
métro » est privilégié par opposition au modèle du « pipe-line ». Le
diplôme de niveau L doit à la fois correspondre à une qualification
professionnelle et à une étape permettant et préparant la poursuite
d’études. Il en est de même pour le diplôme à de niveau M puisque tous les
lauréats ne souhaitent pas obligatoirement effectuer le stage
professionnel de 3 ans et se présenter aux épreuves du diplôme d’expertise
comptable (final).
Les entrées aux différents niveaux doivent être clairement identifiées par
un système de dispenses d’épreuves, comme le prévoit le régime
actuellement en vigueur. Cela permettra également d’organiser les
passerelles entre le cursus actuel et le nouveau. L’examen des demandes de
dispenses relève des compétences de la Commission consultative pour la
formation professionnelle des experts-comptables qui est présidée par le
directeur de l’enseignement supérieur ou son représentant. La complexité
de ce dispositif de dispenses est due à la très grande variété des
situations rencontrées mais il permet de gérer de façon instantanée et
équitable la plupart des demandes et d’ouvrir largement les recrutements à
des profils différents. Il y a donc complexité d’abondance (grand nombre
de situations) mais simplicité de sens (pas de problèmes d’interprétation
ou de décisions divergentes en fonction du moment ou du lieu, ce qui
serait source de nombreuses contestations).
Par ailleurs, un dispositif permettant la validation des acquis de
l’expérience (VAE) sera mis en place.
ECTS =
European Credit Transfer System . L'ECTS est une unité de mesure
permettant d'apprécier le niveau d'approfondissement d'un enseignement et
d'instruire plus facilement les dossiers des étudiants qui, au cours de
leurs études, changent d'établissement de formation et plus encore
changent de pays. L'objectif est clairement d'encourager la mobilité
internationale des étudiants au sein de l'Europe. A titre très indicatif,
1 ECTS = 12 heures de cours. Mais les ECTS incluent également le travail
personnel.
Les titulaires d’un master ou d’un diplôme ayant le grade de master,
quelle que soit la discipline, pourraient avoir accès directement aux
épreuves du diplôme + 5. Si le diplôme de master ou le diplôme ayant le
grade de master couvre tout ou partie du programme du diplôme + 5, des
dispenses d’épreuves pourraient être accordées. La Commission consultative
pour la formation professionnelle des experts-comptables examine au cas
par cas la correspondance des contenus, des niveaux et des ECTS.
Le GRECE ?
Le GRECE est une structure de
projet, informelle, à laquelle la Commission consultative a délégué le
soin de faire des propositions de réforme des programmes.
A une simple mise à jour des programmes, le GRECE a préféré une remise à
plat complète du fait des évolutions importantes constatées depuis 1981,
date de mise en place du cursus actuel. De plus, il a été décidé de partir
des contenus définis par les divers référentiels ou modèles européens et
internationaux et des besoins de la profession. Ce sont ces contenus qui
conduisent à un découpage en épreuves et non l’inverse.
Le projet de programme a été préparé par neuf groupes de travail, soit un
pour chaque discipline, placés sous la responsabilité d’un rapporteur,
professeur de l’enseignement supérieur. Les autres membres représentaient
de façon équilibrée l’enseignement supérieur, l’enseignement du second
degré et la profession comptable (experts-comptables et commissaires aux
comptes).
Les travaux de ces groupes de travail ont été ensuite présentés au groupe
plénier puis discutés et amendés avant diffusion. Le groupe plénier était
constitué des rapporteurs de chaque groupe de travail, d’un représentant
de la direction de l’enseignement supérieur, d’un représentant de
l’inspection générale et de représentants de la profession comptable.
Après exploitation des réponses à la présente consultation, le GRECE a
transmis le résultat de ses travaux à la Commission consultative du 26
avril 2005 qui est seule compétente pour proposer au ministre de
l’Education nationale une rédaction du nouveau décret et de son arrêté et
les mettre dans le circuit des signatures des différents ministres
concernés. Ces derniers documents oont fait l’objet d’un examen à la
Commission consultative du 31 mai 2005.
Quels programmes ?
Le
découpage du programme préfigure évidemment les épreuves. Chaque programme
est présenté sous forme d’un tableau comportant trois colonnes :
-
les thèmes à traiter ;
-
le sens et la portée de
l’étude (cette colonne permet d’identifier le message à faire passer et
justifie le fait que tel thème soit à traiter) ;
-
les notions et contenus à
construire c’est-à-dire le détail de ce qui doit être étudié et peut
donc être posé à l’examen.
Cette présentation met mieux en
perspective les contenus, leur donner un sens, ce qu’une simple liste
permet plus difficilement de faire.
Afin de mieux guider les enseignants, les candidats et les concepteurs de
sujets d’examens, des nombres d’heures d’enseignement sont associés à
chaque thème. Il s’agit bien sûr d’une indication. En fonction des
publics, les volumes horaires nécessaires pour assimiler telle ou telle
partie peuvent varier. Il faut souligner qu’en dehors des heures
d’enseignement, un travail personnel est exigé avec un poids relatif plus
important au niveau M qu’au niveau L.
Le niveau L se situe un peu en dessous du DECF et se nomme « diplôme de
comptabilité et de gestion » (DCG). Le niveau M est un peu au dessus du
DESCF et se nomme « diplôme supérieur de comptabilité et de gestion » (DSCG).
Le programme proposé a quelques
caractéristiques qu’il convient de souligner :
-
dans la mesure où il couvre
cinq années (3 + 2) d’études à temps plein, il est découpé selon un
rythme d’approximativement 4 épreuves par année ;
-
les 5 années correspondent à
un peu plus de 3 000 heures de cours ce qui est comparable à la durée
des formations comptables supérieures équivalentes observées dans les
pays les plus développés ;
-
l’anglais devient une langue
obligatoire au niveau L et au niveau M ;
-
les épreuves de niveau L sont
plutôt centrées sur des techniques ou des concepts monodiciplinaires ;
-
les épreuves de niveau M sont
plus largement contextualisées et transversales et supposent évidemment
que soit connu le programme de niveau L de la ou des disciplines
correspondantes ;
-
un stage ou une expérience
professionnelle contrôlée et validée est nécessaire aux deux niveaux
puisque chaque niveau peut être une fin de parcours ;
-
une épreuve facultative
(pouvant seulement apporter des points supplémentaires) de langue
vivante étrangère autre que l’anglais est proposée aux niveaux L et M ;
-
l’audit (révision légale et
contractuelle) et l’éthique professionnelle constituent l’essentiel du
programme du diplôme d’expertise comptable qui est se situe après le
stage réglementaire, ce qui explique que cette partie est peu développée
ici et devra faire l’objet d’une réflexion sur la formation des
experts-comptables stagiaires ;
-
le programme de systèmes
d’information préconisé par l’IFAC (IEG 11) est très lourd. S’il devait
être pleinement adopté, une épreuve supplémentaire au niveau M serait
nécessaire Il est proposé de se limiter dans ce domaine faute de pouvoir
alourdir davantage les programmes ;
-
les mathématiques appliquées
à la gestion (mathématiques financières, statistiques, probabilités,
etc.) ont été intégrées en tant que de besoin dans les UE concernées
(notamment en finance et en contrôle de gestion).
Source :
CSOEC
>
Projet de décret
>
Tableau des équivalences